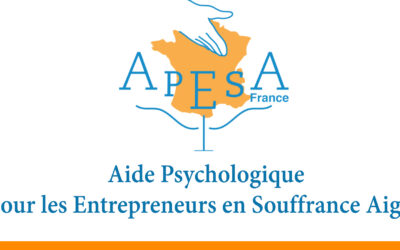Cet article retrace le déroulement d’une enquête sur le harcèlement moral dans un laboratoire de recherche lyonnais. Celle-ci a permis de révéler au grand jour des agissements largement diffusés depuis de longues années, mais jusqu’alors jamais sanctionnés. Nous proposons un retour sur la démarche menée dans le cadre des instances représentatives du personnel, ses succès et ses difficultés.
La question du harcèlement moral au travail connait aujourd’hui une attention importante. Le jugement qui a récemment consacré la qualification de harcèlement moral institutionnel[1] dans le procès France Telecom rappelle que cette affaire est tout autant précurseur que fondamentale dans l’imaginaire collectif autour de la question du harcèlement moral[2].
Le milieu universitaire est particulièrement concerné par des violences liées à une forte méconnaissance du droit du travail et à la structure des relations professionnelles : souvent, l’entrée dans la carrière dépend de la bonne relation avec un·e responsable de recherche ou de laboratoire, ce qui est un frein au signalement des violences subies.
Notre article propose l’étude d’une situation que nous avons portée en tant que syndicalistes dans notre établissement universitaire, et qui a abouti à la reconnaissance, par notre institution, de situations de harcèlement trop longtemps passées sous silence. Alors que beaucoup de choses ont été faites pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans les universités[3], la question du harcèlement moral est encore laissée de côté, malgré des besoins prégnants liés à la dégradation des conditions dans lesquelles s’effectuent l’enseignement et la recherche en France. Il est trop souvent considéré comme un problème interpersonnel et non systémique.
Dans un contexte de baisse des financements[4] et de compétition croissante engendrée par une course aux financements créatrice d’instabilité permanente, les violences au travail se multiplient, qu’elles soient sexistes ou non.
Le milieu universitaire est particulièrement concerné par des violences liées à une forte méconnaissance du droit du travail et à la structure des relations professionnelles : souvent, l’entrée dans la carrière dépend de la bonne relation avec un·e responsable de recherche ou de laboratoire, ce qui est un frein au signalement des violences subies. De même, la transformation soudaine d’une relation enseignant/étudiant en une relation entre pairs, crée un terrain propice au harcèlement moral, voire aux violences sexistes et sexuelles[5].
La prise en charge des victimes, « épuisante et défectueuse »[6], encore balbutiante, est peu reconnue et relève du travail gratuit dans le cas des violences sexistes et sexuelles. Dans ce contexte, comment espérer rendre audible le harcèlement moral et la reconnaissance de ses victimes au travail[7] ? Nous proposons ici un retour d’expérience qui peut servir de méthode à la construction d’autres enquêtes et aider à la libération d’une parole trop longtemps passée sous silence[8].
…
Lire la suite, « « Ça ne changera jamais » : chronique du mal-être dans le travail de recherche », sur le site https://mouvements.info

————————–
Notes :
- Décision sur le pourvoi n°22-87.145 de la Cour de Cassation (en ligne : https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2025/01/21/communique-reconnaissance-du-harcelement-moral-institutionnel).
- Voir notamment le numéro de la revue Travailler publié en 2021 sur le sujet : « Le jugement France Télécom : un tournant juridique historique ? ».
- On peut notamment citer le travail du CLASCHES, Collectif de lutte antisexiste contre le harcèlement dans l’enseignement supérieur. La circulaire du 9 mars 2018 oblige les établissements d’enseignement supérieur à se doter de dispositifs d’alerte et de signalement contre les violences sexuelles et sexistes. Voir aussi le témoignage publié dans la revue Mouvements en 2023 : « Témoignage : dix ans de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans des grandes écoles », Mouvements, n°113, 2023, p. 94-100.
- Amandine Miallier, « La SCSP par étudiant a diminué de 2,3 % en moyenne entre 2016 et 2022. Le détail par université », AEF Info, 20 novembre 2023 (en ligne : https://www.aefinfo.fr/depeche/702844-la-scsp-par-etudiant-a-diminue-de-23-en-moyenne-entre-2016-et-2022-le-detail-par-universite, consulté le 27 février 2025).
- Voir le rapport détaillé de l’étude « Pressions, silence et résistances » sur les violences sexistes et sexuelles et les discriminations en milieu doctoral en France, réalisée en 2024 par l’Observatoire des violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur.
- Farah Deruelle et Julie Jarty , « Qui gère les violences sexuelles à l’université ? Coût et pénibilité d’un (autre) travail académique », Nouvelles Questions Féministes, Vol. 43, no 2, 2 janvier 2025, p. 78-93.
- Cette difficulté est particulièrement présente dans la fonction publique, où la vulnérabilité des agents victimes de harcèlement moral est moins reconnue, comme l’expliquent A.-S. Denolle et F. Gabroy, « Vulnérabilité et harcèlement moral : étude comparée du droit de la fonction publique et du droit du travail », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, no 18, 19 novembre 2020, p. 65-72.
- L’ouvrage d’Adèle Combes sur le sujet a rencontré un succès important. Voir Adèle. B. Combes, Comment l’université broie les jeunes chercheurs: précarité, harcèlement, loi du silence, Paris, Éditions Autrement, 2022. Voir aussi Alice Raybaud, « Plagiat, vol, appropriation de thèses… quand les encadrants s’emparent du travail des jeunes chercheurs », Le Monde, 25 janvier 2022.
SOUFFRANCE AU TRAVAIL : ne restez pas seuls !
Consultez l’annuaire des consultations Souffrance & Travail
L’annuaire des consultations Souffrance & Travail recense plus de 200 consultations réparties sur toute la France, en Europe et dans les Dom Toms.



![[ÉCOUTER] Thomas Périlleux : Les pathologies des travailleurs, la pathologie du travail](https://www.souffrance-et-travail.com/wp-content/uploads/2023/01/ecouter-regarder-voir-400x250.jpg)