« “Répondez s’il vous plait à cet e-mail en citant approximativement cinq choses que vous avez accomplies la semaine dernière.” Ce message a été envoyé aux fonctionnaires américains samedi dernier. J’ai essayé d’y répondre, en me demandant ce qui méritait d’être mentionné.
Alors, j’y vais, en vrac et à la Pérec. J’ai débité un arbre dans le jardin de mon père (trois heures). Je suis allé voir une exposition de photo (une heure). J’ai fêté un anniversaire (une nuit). J’ai signé un acte chez l’avocat (vingt minutes, mais rassembler les documents a pris des semaines). J’ai mené des entretiens et rédigé des articles, dont certains prévus de longue date (sur une durée difficile à évaluer).
Une conception étriquée du travail, réduit à la tâche
On le voit, ces listes, comme celles qu’exigent des agents fédéraux les équipes du Doge, le département de l’Efficacité gouvernementale pris en main par Elon Musk, sont absurdes. Confinées à la sphère professionnelle, elles traduisent d’abord une conception étriquée du travail, réduit à la tâche.
Elles ont surtout pour ambition de terroriser les administrations. Un ultimatum a ainsi été fixé, et ceux qui ne répondent pas seront considérés comme démissionnaires… Or dans les jours qui ont suivi, c’est dans les rangs du Doge qu’une grande démission a eu lieu. Un tiers de l’équipe a collectivement cessé de servir, n’entendant pas utiliser ses compétences “pour fragiliser les systèmes informatiques gouvernementaux cruciaux, compromettre les données sensibles des Américains ou démanteler des services publics essentiels”.
Le nouveau coup de boutoir du milliardaire pose néanmoins trois questions.
Une question éthique, d’abord.
Qu’opposer à cette injonction ? Une attitude pragmatique pourrait consister à donner une réponse dérisoire, peu coûteuse en temps et en énergie, qui moque l’effet voulu par le Doge, sans prendre de risque.
L’autre option est de ne pas répondre, considérant cette menace comme un coup de bluff et qu’il n’est, de toute façon, pas question d’entrer dans un système de surveillance généralisée ni d’avaliser cette dystopie panoptique.
Parlant du tyran, La Boétie écrit ainsi dans son Discours de la servitude volontaire que le “maître” n’a que “les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire”. Alors, poursuit-il, “soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libres. Je ne vous demande pas de le pousser, de l’ébranler, mais seulement de ne plus le soutenir, et vous le verrez, tel un grand colosse dont on a brisé la base, fondre sous son poids et se rompre.” Une vingtaine de fonctionnaires ont eu ce courage de résister.
Une question ontologique, ensuite.
Qu’est-ce qu’accomplir une chose ? Dans la liste que j’ai dressée apparaissent des actes productifs, techniques (couper un arbre ou construire une fusée), ce qu’Aristote appelle la poiesis, et des actes non-productifs (organiser une réunion ou faire de la politique, par exemple), qui relèvent, pour le philosophe, plutôt de la praxis, d’un perfectionnement de soi dans l’action.
Il existe par ailleurs des actes délimités dans le temps et d’autres qui n’ont pas de limites claires : quand commence-t-on à divorcer, par exemple ? Un article a-t-il déjà pris forme dans ma tête quand je projette de l’écrire ou est-il finalisé quand le lecteur s’en empare ? Comment savoir quand cela a commencé et commencé à finir ?
Aristote distingue la puissance et l’acte – le gland est ainsi un chêne en puissance, qui se réalise dans la croissance de l’arbre. Le philosophe emploie le terme d’entéléchie pour désigner non seulement cette puissance qui se réalise en acte, mais ce qui a été parfaitement accompli. Où l’on en vient à la dernière question.
Une question existentielle, enfin.
…
Lire la suite sur le site de Philosophie Magazine


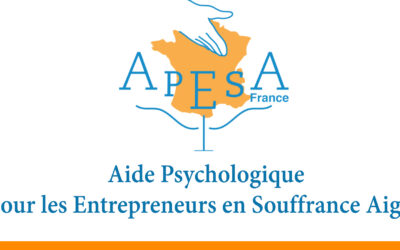


![[INRS – Décembre 2024] Effets des expositions psychosociales sur la santé des salariés. Mise à jour des connaissances épidémiologiques](https://www.souffrance-et-travail.com/wp-content/uploads/2024/08/lire-2-400x250.jpg)
